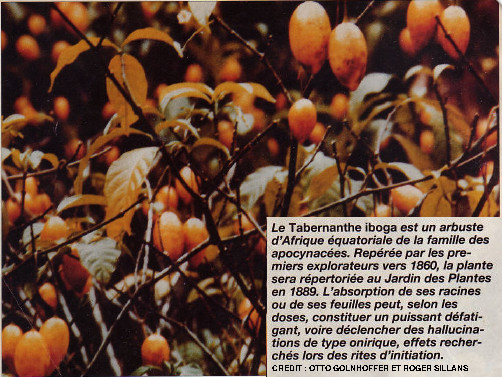
Paradoxe: cette plante africaine aux effets psychotropes
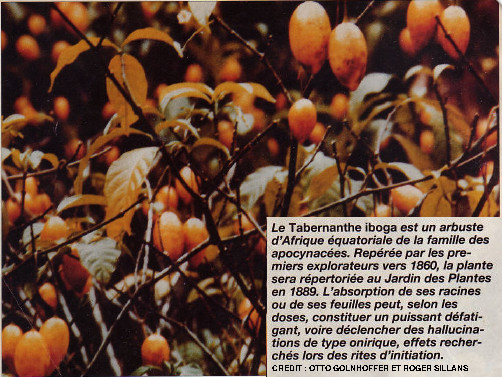
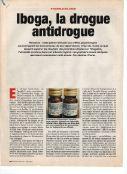 Sciences et Avenir -
mai 1993
Sciences et Avenir -
mai 1993
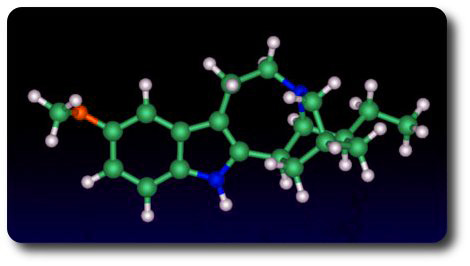 Aujourd’hui,
cette plante est l’objet de recherches qui permettront
peut-être de découvrir un traitement efficace
contre la toxicomanie. L’idée de proposer un
psychotrope contre des narcotiques peut paraître paradoxale,
mais l’iboga possède de bien étranges
propriétés qui pourraient se
révèler très efficaces.
Aujourd’hui,
cette plante est l’objet de recherches qui permettront
peut-être de découvrir un traitement efficace
contre la toxicomanie. L’idée de proposer un
psychotrope contre des narcotiques peut paraître paradoxale,
mais l’iboga possède de bien étranges
propriétés qui pourraient se
révèler très efficaces.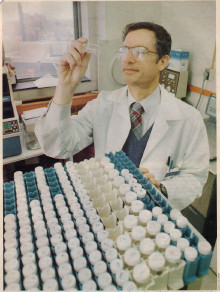 Les
premiers résultats indiquent que, chez le rat,
l'ibogaïne oinhibe la stimulation dopaminergique
“normalement observée après une dose
modérée de morphine”. Mais les auteurs,
en particulier Stanley Glick (ci-contre), pharmacologue de
l’école de médecine d’Albany
(New York), ne sont pas en mesure de décrire avec
précision ce mécanisme d’inhibition.
Curieusement, l’effet de l’ibogaïne parait
persister bien après son élimination par
l’organisme. D’autres effets surprenants ont
été observés sur le comportement des
rats qui, alors qu’ils sont libres de
s’auto-administrer de la morphine, diminuent leur
consommation. Les neurobiologistes consultés par le NIDA ont
aussi partiellement montré que l'ibogaïne pouvait
altérer certains symptômes du syndrome de sevrage en
toxicomanie.
Les
premiers résultats indiquent que, chez le rat,
l'ibogaïne oinhibe la stimulation dopaminergique
“normalement observée après une dose
modérée de morphine”. Mais les auteurs,
en particulier Stanley Glick (ci-contre), pharmacologue de
l’école de médecine d’Albany
(New York), ne sont pas en mesure de décrire avec
précision ce mécanisme d’inhibition.
Curieusement, l’effet de l’ibogaïne parait
persister bien après son élimination par
l’organisme. D’autres effets surprenants ont
été observés sur le comportement des
rats qui, alors qu’ils sont libres de
s’auto-administrer de la morphine, diminuent leur
consommation. Les neurobiologistes consultés par le NIDA ont
aussi partiellement montré que l'ibogaïne pouvait
altérer certains symptômes du syndrome de sevrage en
toxicomanie. 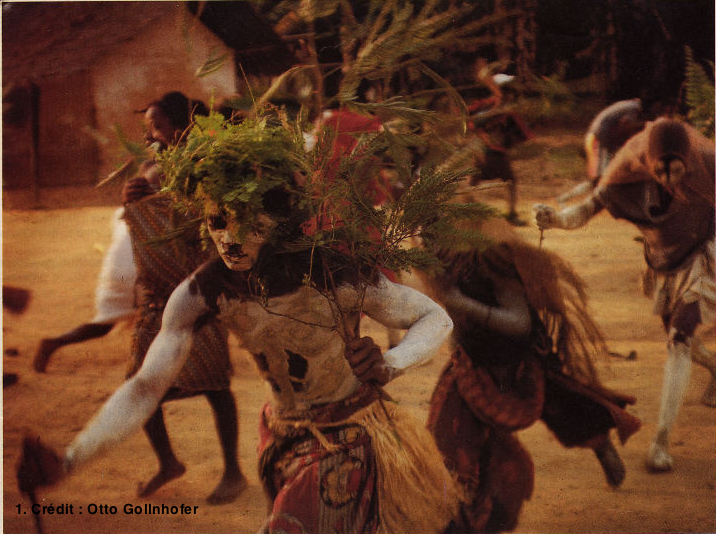 En terme de
dépendance physique, les spécialistes
écartent cette hypothèse, au même titre
que les autres psychostimulants. Côté psychique
— la motivation principale de toute addiction —
tout dépend du caractère
“agréable” de l'expérience
hallucinogène. “C ‘est une
expérience éprouvante, voire plutôt
douloureuse,” indique Otto Gollnhofer, un ethnologue du CNRS
qui fut le premier à observer les aspects psychosensoriels
de l’ibogaine sur l’homme, en
s’introduisant chez les Mitsogho dès 1961. Pour
Marc Valleur, psychiatre et adjoint du Pr Olievenstein au Centre
Marmottan, “l’idée reste la
même que l’usage du LSD pour traiter les
schizophènes dans les années soixante.
L’originalité vient de ce qu’on en
reparle par le biais de la psychopharmacologie, et non par le biais du
psychédélisme des “hippies”
californiens. Mais je ne suis pas sûr que ce soit plus
sérieux.”
En terme de
dépendance physique, les spécialistes
écartent cette hypothèse, au même titre
que les autres psychostimulants. Côté psychique
— la motivation principale de toute addiction —
tout dépend du caractère
“agréable” de l'expérience
hallucinogène. “C ‘est une
expérience éprouvante, voire plutôt
douloureuse,” indique Otto Gollnhofer, un ethnologue du CNRS
qui fut le premier à observer les aspects psychosensoriels
de l’ibogaine sur l’homme, en
s’introduisant chez les Mitsogho dès 1961. Pour
Marc Valleur, psychiatre et adjoint du Pr Olievenstein au Centre
Marmottan, “l’idée reste la
même que l’usage du LSD pour traiter les
schizophènes dans les années soixante.
L’originalité vient de ce qu’on en
reparle par le biais de la psychopharmacologie, et non par le biais du
psychédélisme des “hippies”
californiens. Mais je ne suis pas sûr que ce soit plus
sérieux.”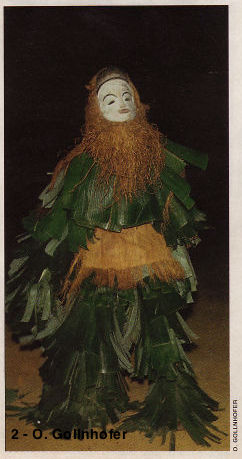
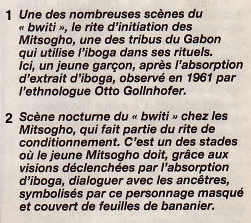 Les témoignages
anecdotiques dont parle la neurologue de Miami proviennent
d’un certain Howard Lotsof, l’un des premier a
remarquer les pouvoirs de l’ibogaine sur la
dépendance aux narcotiques. Il se bat depuis près
de dix ans pour que la médecine se penche sur les
propriétés des alcaloïdes de
l’arbuste africain. Il aurait
expérimenté sur lui-même et quelques
amis toxicomanes les vertus de l’ibogaïne. Depuis
1989, il organise aux Pays - Bas des séjours de traitements
cliniques auprès de toxicomanes
“volontaires”. Assez volontaires pour
débourser parfois jusqu’à 20.000
dollars pour 10 jours de traitement. En trois ans, une cinquantaine de
malades se sont succédés. Des
Américains, Néerlandais, Israéliens ou
Suisses, dépendants de l’héroine, voire
de la méthadone. Résultat, difficilement
vérifiable: environ un quart d’entre eux auraient
“décroché” au moins pour six
mois.
Les témoignages
anecdotiques dont parle la neurologue de Miami proviennent
d’un certain Howard Lotsof, l’un des premier a
remarquer les pouvoirs de l’ibogaine sur la
dépendance aux narcotiques. Il se bat depuis près
de dix ans pour que la médecine se penche sur les
propriétés des alcaloïdes de
l’arbuste africain. Il aurait
expérimenté sur lui-même et quelques
amis toxicomanes les vertus de l’ibogaïne. Depuis
1989, il organise aux Pays - Bas des séjours de traitements
cliniques auprès de toxicomanes
“volontaires”. Assez volontaires pour
débourser parfois jusqu’à 20.000
dollars pour 10 jours de traitement. En trois ans, une cinquantaine de
malades se sont succédés. Des
Américains, Néerlandais, Israéliens ou
Suisses, dépendants de l’héroine, voire
de la méthadone. Résultat, difficilement
vérifiable: environ un quart d’entre eux auraient
“décroché” au moins pour six
mois.| Haroun TAZIEFF, célèbre géologue et vulcanologue français,
directeur honoraire au CNRS, décrit l'expérience qu'il fit du
Lambarène dans son livre: "Le gouffre de la Pierre St-Martin" (Arnaud
Ed).
- "Vas-y, me dit André (médecin de l'expédition) ça te donnera des forces. Et avale aussi ceci, ajouta-t-il en me tendant un comprimé. -Crois-tu qu'il faille déjà en prendre ? ne vaudrait-il pas mieux réserver ça pour les coups de pompe ?" C'était du Lambarène, un excitant, un "dopant" qui devait nous permettre de trouver dans nos corps épuisés la force nécessaire. -Non, vas-y, il faut prévenir les coups de pompe. Nous en prendrons d'autre tout-à-l'heure, régulièrement... Nous avions avalé, à l'instant, notre troisième comprimé de Lambarène, et un effet tonique se faisait sentir. Je me hâtais, dopé au Lambarène, sautant d'un bloc à l'autre avec une agilité retrouvée... Je commençais, malgré le Lambarène, à ressentir durement la fatigue, j'avais de la peine à escalader les blocs énormes qu'il fallait redescendre ensuite aussitôt, pour attaquer le suivant, des crampes insidieuses rampaient dans la partie antérieure des cuisses. Pourvu qu'elles n'augmentent pas... Je pris un nouveau Lambarène. Pendant qu'André escaladait l'échelle, je me massais les jambes. En dix minutes, tout était en ordre et je montais à mon tour sans difficulté... Malgré le Lambarène que je venais d'avaler, je ne me sentais pas loquace du tout. Le temps coulait. L'eau aussi. Une heure passa, l'effet du Lambarène aussi... Et, cette ultime journée, cette course effrénée à la découverte, ces six heures de descentes et de grimpées, à coups de Lambarène, cette journée ajoutée aux autres, terrible... Seul, l'excitant nous avait permis de tenir. L'effet du dernier comprimé passé, n'en ayant pas d'autres, je ne fus qu'un lamentable paquet de viande misérablement pendu au bout d'un fil." Depuis 1989, cet alcaloïde fait partir des produits dopants interdits par le CIO, l'Union internationale du cyclisme et le Secrétariat d'Etat de la Jeunesse et des Sports. |
| Source : R. Goutarel, 1999 |